Langue sémitique parmi les plus anciennes encore utilisées, l’arabe se distingue par sa richesse lexicale, sa structure grammaticale complexe et sa profonde dimension culturelle. Parlée par près de 500 millions de personnes à travers le monde, l’arabe s’est imposée comme langue de poésie, de science et surtout de religion. L’un des tournants majeurs de son histoire fut la révélation du Coran, texte sacré de l’islam, qui en a fait une langue de référence spirituelle et linguistique. Nous allons donc voir ici les origines de la langue arabe, son rôle dans la révélation coranique et les enjeux modernes de la langue arabe coranique.
La langue arabe appartient à la grande famille des langues sémitiques, au même titre que l’hébreu, l’araméen ou encore l’akkadien. Elle s’est développée progressivement dans la péninsule arabique, où coexistaient plusieurs formes dialectales selon les régions et les tribus. Les premières traces écrites de la langue arabe remontent au 13ᵉ siècle avant J.-C.
Avant l’avènement de l’islam, la langue arabe s’exprimait essentiellement à l’oral. La poésie y occupait une place centrale, notamment dans les foires et les rassemblements tribaux. Les Mu‘allaqāt (ٱلْمُعَلَّقَات), ces poèmes suspendus selon la tradition à la Kaaba, témoignent d’une grande richesse lexicale et stylistique de la langue arabe. Cette tradition poétique a joué un rôle fondamental dans la structuration et la conservation des formes linguistiques de l’arabe préislamique.
Ce contexte oral et tribal a façonné une langue arabe qui est souple, expressive, dont les structures syntaxiques et le lexique étaient principalement maîtrisés par les poètes. Ce patrimoine culturel a préparé le terrain à l’émergence d’un arabe plus normatif : celui du Coran.

Avec la révélation du Coran au prophète Muhammad (que la paix soit sur lui) au VIIe siècle, la langue arabe connaît une transformation majeure. Le texte sacré affirme à plusieurs reprises avoir été révélé « en arabe clair » (bi-lisân ‘arabiyy mubîn), soulignant la volonté divine de s’adresser au peuple dans sa propre langue.
Le style de l’arabe coranique se distingue par son rythme, ses assonances, ses images puissantes et son agencement particulier des phrases. Son impact fut tel que les opposants eux-mêmes reconnaissaient la singularité et la force persuasive de cette parole divine. L’un des aspects perçus comme miraculeux du Coran était précisément sa forme linguistique, qui dépassait les normes de la poésie ou de la prose de l’époque. Un style qui était difficile à attribuer à une personne illettrée, tel que le prophète Muhammad. L’utilisation de ce style coranique s’agit d’une preuve irréfutable de la révélation du Coran par Dieu (Allah) pour un grand nombre.
Pour préserver cette langue sacrée, les premières générations de musulmans ont entrepris une vaste entreprise de transcription et de standardisation. L’arabe écrit, jusqu’alors peu utilisé, fut raffiné : on introduisit progressivement les points diacritiques pour distinguer les lettres (par exemple : ب، ت، ث) ainsi que les signes de vocalisation (harakāt) pour garantir une récitation fidèle. Ainsi, le Coran a servi de pionnier pour le développement d’un arabe écrit rigoureux et normé.
Lire aussi :

Apprentissage basé sur le Coran
493 Avis Google 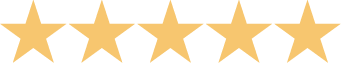
De nos jours, la langue arabe demeure profondément marquée par son lien au Coran. L’arabe classique, ou fusha, reste la langue de la liturgie musulmane, des sermons, des prières et des cours religieux. Des millions de musulmans à travers le monde apprennent l’arabe coranique dès leur plus jeune âge, même sans être arabophones. Cette pratique assure une transmission continue de l’arabe coranique au sein de la communauté musulmane.
Cependant, ce lien sacré entre langue et religion soulève aussi des enjeux contemporains. Le principal est celui de la diglossie : dans la majorité des pays arabes, on parle au quotidien des dialectes arabes régionaux (darija, égyptien, syro-libanais, etc.) très différents de l’arabe classique. Cette distance crée parfois une fracture entre la langue parlée et la langue sacrée.
Par ailleurs, l’arabe classique doit faire face aux défis de la modernité : intégrer les termes scientifiques, technologiques et sociaux tout en respectant son cadre grammatical rigide. Des académies de langue arabe travaillent activement à forger de nouveaux mots, mais ces efforts peinent souvent à s’imposer dans l’usage courant, les mots étrangers prenant le dessus.
Malgré ces défis, l’histoire de la langue arabe est indissociable de celle du Coran. En tant que texte sacré, le Coran a permis de transformer l’état de la langue arabe en réhaussant l’éloquence et en la codifiant. Il a permis à l’arabe de se diffuser dans un vaste espace géographique et culturel, devenant langue de civilisation. Aujourd’hui encore, la langue arabe continue de vivre entre tradition et modernité, portée par la récitation du Coran et la richesse de son héritage.
Lire aussi :